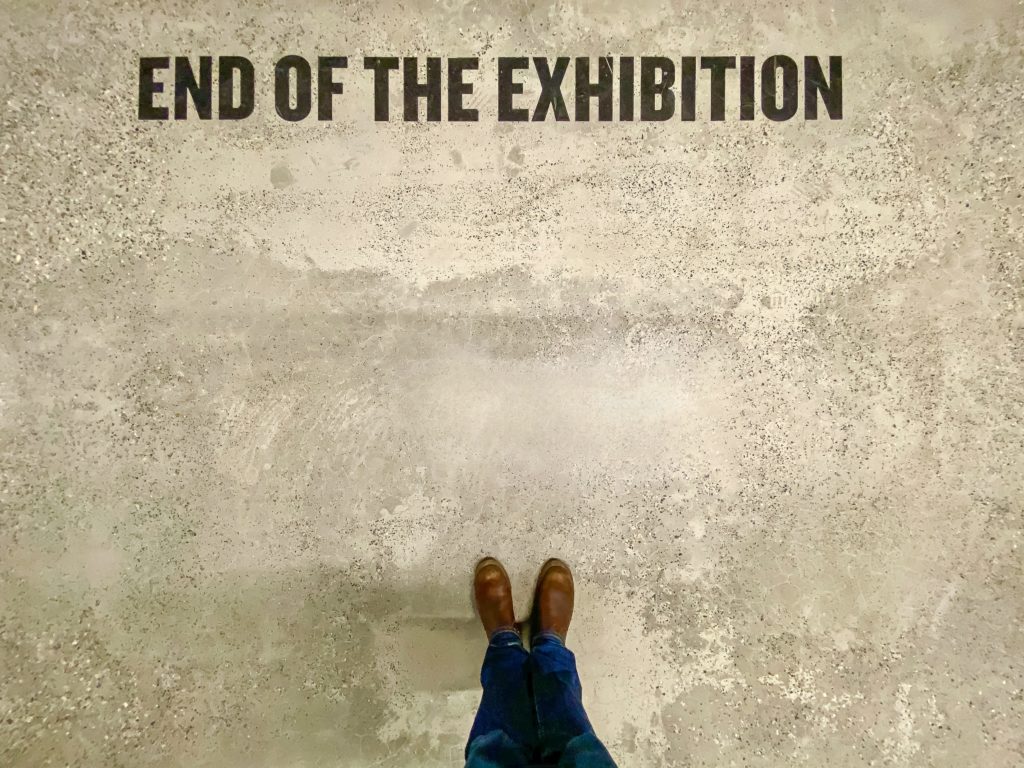Dans l’article précédent, je vous avais laissé à « ok j’ai beaucoup lu, j’ai le script qui me sort par les pores de la peau, il est grand temps ». Bon. Cette sensation que le texte se précipite pour être écrit ne dure que quelques heures, jusqu’à ce que les choses évidentes soient couchées sur le papier, et que je me heurte aux premières questions de pertinence, aux premiers manques d’information, aux premiers oublis. Je savais bien qu’il n’allait pas couler de source, mais je ne pensais pas y passer autant de temps – dans mon souvenir, je crois, sept jours de rédaction ?
En venir au script : pédagogie et culture de l’écrit
Je ne savais pas encore que j’allais finalement opter pour deux vidéos, et j’ai laissé venir les choses, dans un premier temps, sans me soucier de longueur. Dans mon précédent article, je vous disais que mes méthodes de travail ont évoluées vers des vidéos plus longues. Ce relâchement lors de l’écriture du script est relativement nouveau, et il accompagne la venue de vidéos étendues, voire en deux parties. Il permet de rentrer tranquillement dans les détails, sans que je me force à opter pour des formulations ultra compactes et précises – précisions qui, pour le néophyte, auraient besoin d’être longuement explicitées pour qu’il ou elle en saisisse la teneur et la subtilité. Le court, en histoire des idées, quand on approfondit ne serait-ce qu’un peu, me semble l’ennemi de la pédagogie. Le long aussi, me direz-vous, surtout quand il est rempli de formules compliquées. Il faut donc bien soigner ses phrases : les découper autant que possible pour les rendre plus courtes et utiliser soit 1) un vocabulaire technique qu’on aura préalablement bien défini et dont on ne déviera pas ; 2) des termes du langage courant (mais alors il en faudra plus, car ils sont nécessairement moins précis et ne servent qu’en remplacement de termes adéquats – on est donc perpétuellement dans la comparaison ou autre figure de style à visée pédagogique). En général, je fais un peu des deux : utiliser le vocabulaire des auteurs et autrices en le définissant avec précision, et tomber dans le « vulgaire » pour traduire/trahir, mais fournir un gros chausse-pieds à la compréhension. Et, bien sûr, trier et condenser les informations.
Ce qui est difficile à prendre en compte, c’est le fait que : la vidéo. Pour moi qui ai passé la quasi entièreté de ma vie dans l’écrit, je sais que le texte a ceci de praticable qu’il se lit et se relit (ad nauseam ou ritournelle). Lorsque j’ai enseigné, j’ai fait l’expérience de la répétition orale et de l’adaptation à mon public. Bien sûr dans les conditions actuelles (toujours plus dégradées) de l’enseignement en France, quand votre classe est pleine à craquer, que vous souhaiteriez parler avec micro et ampli pour pouvoir atteindre le fond de la salle, la répétition ne remplit pas vraiment son rôle. Il y a trop à faire en même temps pour pouvoir réellement s’adapter à l’entièreté de son public et l’impliquer dans le travail d’explication et de ré-explication. Vous me direz : la vidéo, certes, on ne peut pas faire de différenciation pédagogique et de reformulation sur le vif, mais comme le texte, on peut se la repasser si on le souhaite. Oui, bien sûr qu’on peut. Mais qui le fait ? Il serait illusoire pour mon cas, je crois, d’avoir pour ambition une telle limpidité que tout le contenu serait transmis au premier visionnage.
Je ne suis pas sur un créneau très facile, alors il me semble qu’il faut que j’accepte de ne pas être parfaitement claire tout de suite pour tout le monde. Cependant, dans l’idéal et parce que tout le monde a autre chose à faire que de se repasser des vidéos de machins compliqués, il faut réussir autant que possible à optimiser la transmission, ne pas se dire en permanence « ben y vont démerder si ça les intéresse vraiment ». Déjà c’est un peu feignant, pour quelqu’un qui, comme moi, se donne pour objectif de faire de la vulgarisation. Et puis c’est sacrément élitiste. Tout le monde sait très bien qui pourra « faire l’effort de se débrouiller si ça l’intéresse » – quelqu’un de déjà intéressé, et avec une certaine culture. S’il y a des nuances qu’on ne peut effacer sans vider totalement le contenu de ce qui est vulgarisé, il y a toujours des efforts à faire pour savoir comment faire passer ces nuances sans que ça se manifeste par un vocabulaire et des phrases imbitables.
Et la vidéo dans tout ça ? C’est un long apprentissage, pour moi qui ai une longue habitude du texte pur. Je ne crois pas qu’avec l’approche intellectuelle que je vulgarise il existe déjà un modèle de transmission, de mise en scène, de dispositifs pédagogiques à imiter. D’autre part, ma culture audiovisuelle était encore, il y a peu, proche du néant. La possibilité d’innover tient à la maîtrise des outils et des codes, alors il me faut faire un pas après l’autre. Je reste donc, pour le moment, sur un script formellement très proche d’un écrit qui pourrait être seulement lu. La phase de création de l’infographie est encore seconde, et part du fil rouge solidement fini du script.

Partir à la boussole
Les débuts d’un script, c’est toujours un peu brouillon (sans grande surprise, me direz-vous). Souvent, ça commence par quelques paragraphes d’introduction, qui posent les premières bases, puis je fais une liste des points à aborder – la plupart du temps elle me vient presque dans l’ordre définitif, et la seule modification consiste à la raffiner pendant la rédaction, parce que je vois bien qu’une partie commence à prendre beaucoup plus d’ampleur que prévu. Par exemple, dans la première vidéo, la partie « Les communs : outils pratique » était au début pour moi une seule partie. Puis, quand je me suis rendue compte du nombre de mots que me prenait ne serait-ce que d’introduire cette partie et de rédiger le bout sur les communs mondiaux, j’ai commencé à découper tout ça.
Dans un script, il y a des parties parties qui vont de soi, et d’autres qui sont des enfers. Je savais d’emblée que j’allais commencer par parler de Hardin et Ostrom. C’est un peu la tarte à la crème de la thématique. Aussi, la partie « Le thème s’impose » m’a relativement bien coulé sous les doigts. C’est très documenté, très commenté : on a le choix. En revanche, tirer un tableau complet et précis tant de l’héritage d’Ostrom que de la veine critique des penseurs des communs allait être un peu plus compliqué. Sachant l’importance d’Ostrom, il allait falloir consacrer à ses héritages intellectuels (peut-être que c’est plus précis de donner dans le pluriel à cet égard) un espace conséquent. Cependant, ce dont je n’avais pas conscience en commençant ma documentation, c’est que les travaux d’Ostrom sur les communs et ses continuateurs les plus directs se tiennent du côté du statu quo. Mais ça, c’était parce que ce que je n’avais pas encore vu, c’était la tête du texte de Hardin. Je m’attendais effectivement à un texte de défense et promotion de la propriété privée néolibéral, mais ce n’est qu’en le lisant que je me suis rendu compte de sa véritable teneur. J’ai été soufflée par le fait que ce texte, qui a été à l’origine d’autant de littérature à propos des communs, était en réalité… ben un torchon à l’argumentaire indigent, suintant le racisme (le tout publié dans Nature, ha, ha). Du coup, forcément, on partait de vraiment très, très loin. Donc partant de là, le statut quo d’Ostrom, c’était « déjà quelque chose » (et pas une petite révolution comme je pouvais me le figurer, plutôt « sauver les meubles »).
Et il ne fallait pas en rester là. Je le savais déjà, mais j’avais mal évalué, je crois, le grand écart entre Ostrom et la pensée critique, les mouvements militants. Je comprenais en cours de route que, quelque part, il y avait deux courants très différents, qui gravitaient autour d’un même terme, mais dont les racines intellectuelles ne trempaient clairement pas dans la même eau. Faire état de cela était relativement compliqué, parce que ma littérature secondaire était réduite à peau de chagrin – quelques lignes dans des introductions d’ouvrage d’histoire, quelques pages dans le Communs de Dardot et Laval… et puis voilà. J’ai donc dû exploiter à fond ces quelques ressources, et les croiser avec des notices de dictionnaire et des lectures de sources premières.

Je navigue ainsi : j’ai un gros fichier de prises de notes de ma documentation préalable (34 pages pour ces deux vidéos, relativement raisonnable), je relis les pages de ce fichier contenant les infos qui m’intéressent à chaque partie de mon script (ctrl+f est mon ami), je retourne aux livres d’où sortent les notes en question pour revoir tout en précision, si besoin aussi pour chercher les sources premières à lire pour développer des exemples, et à chaque fois que je bute sur un mot, une thématique, un terme, je vérifie s’il n’y aurait pas une notice de dictionnaire spécialisé pour me mettre le pied à l’étrier – voire pour régler mon problème. Par exemple, pour la partie « Outil #1 : des communs mondiaux », j’ai zoné entre mes notes sur Communs, 3-4 pages de l’ouvrage, quelques paragraphe de l’introduction de La Nature en communs, l’ouvrage d’Ostrom La Gouvernance des biens communs, et le Dictionnaire des biens communs (notice « Climat », comme dit dans la vidéo).
Pour la partie « Outils #2 : le développement des territoires », c’était un peu plus compliqué. Là on passait vraiment à « quelques phrases de description allusive » dans mes sources secondaires. Je ne trouvais dans ces texte, même, qu’une seule référence de source première (Fikret Berkes) – ce qui est très insatisfaisant. Vous me direz, pour une vidéo de cette taille, de toute façon, un exemple fait bien l’affaire, même si deux c’est plus confort. Mais intellectuellement, ça ne suffit pas pour créer une catégorie (« les écologues et anthropologues qui héritent de la pensée d’Ostrom et en font usage pour… » voir la vidéo en question). J’allais devoir faire confiance à mes sources secondaires, tout en ayant envie de leur dire : « franchement, une seule réf voire aucune, c’est un peu léger, moi j’aurais pas osé ». Si j’ai fini par trancher dans ce sens, c’est, tout d’abord, parce que je ne peux pas me permettre de faire une thèse à chaque vidéo : à certains moments je dois accorder foi à ce qu’avancent les chercheurs si je veux pouvoir avancer. D’autre part, la même réflexion catégorisante se trouvait dans plusieurs sources secondaires différentes et éloignées dans leurs traditions intellectuelles. Et c’était une catégorisation formulée à chaque fois différemment, sous un angle à chaque fois un peu décalé par rapport aux autres occurrences. Je me suis donc permis d’en déduire : ces gens-là ne se copient pas mutuellement, même s’ils ne s’ignorent pas, et la récurrence de cette catégorisation semble conforter la justesse de cette catégorisation. Il y aurait beaucoup d’objections à porter à ce raisonnement, j’en suis bien consciente. Dans d’autres circonstances je ne m’y autoriserais pas – par exemple si les auteurs qui utilisent cette catégorisation n’avaient pas avec elle un rapport relativement dépassionné. Ou encore : si je n’avais pas si souvent croisé la notion de développement dans mes précédentes lectures (par exemple avec le récemment paru Réchauffement planétaire et douceur de vivre de Johal, Hern et Sacco, ou Peau rouge, masques blancs de Coulthard, ou encore lors de mes travaux pour mes mémoires de master).
Je ne vais pas rentrer plus avant dans les détails, mais : j’ai très longuement tergiversé avant de coucher cette partie, j’ai poncé les bibliographies de Berkes à la recherche de plus d’indices sur d’autres références similaires, j’ai relu Coulthard, mais aussi Johal, Hern et Sacco, j’ai refait un tour ou deux dans le catalogue de la bibliothèque universitaire, j’ai fait maints coucou à Alexandra Elbakyan, j’ai relus mes notes et les textes de La Nature en communs portant sur le colonialisme et le néocolonialisme. Et puis je me suis lancée. J’ai beaucoup écrit, puis j’ai aussi beaucoup coupé mon propre texte, renvoyant à plus tard (et pour les plus pressés, à la bibliographie) le soin de faire le tour de cette question de l’ingérence néocoloniale sous couvert d’écologie, qui est un sujet fort bien documenté, et appelant plus que trois lignes supplémentaires dans un script.
Arrivée là (c’est-à-dire toujours dans la partie « statut quo »), j’avais déjà plus de quatre pages de script, et j’avais à peine effleuré mon sujet. J’ai donc décidé de le traiter en deux vidéos au lieu d’une, et je me suis lancée (après moultes relectures de la première partie) dans la rédaction d’un second script.
Faire des choix
Ce qui est rigolo, c’est que la première partie était sensée être « facile » à écrire, comparé à ce qui m’attendait dans la seconde. Et j’avais pourtant déjà sué sang et eau. Je m’attendais donc à une pente bien raide, et j’avais raison.
« Dénoncer la seconde enclosure » s’est scindée en deux avec l’ajout de « Altermondialisme et antinéolibéralisme » : mieux vaut bien poser le cadre, expliciter la différence d’avec ce qui précède, que de sauter à pieds joints dans le vocabulaire technique et les concepts. Avec cette révolution de « lol ben jvais faire deux vidéos », on passe à ce niveau de luxe : le général et le précis sont désormais ensemble ! [applause] Et ça m’a aussi permis de faire un mini topo sur l’histoire des communaux.
Comparé à la précédente partie, je croulais littéralement sous les références (et j’ai bien souvent visité le palais virtuel d’Alexandra Elbakyan) : le plus dur était de sélectionner et d’organiser sans trop simplifier, et sans m’embarquer dans une partie sur la critique qui soit super hardcore en terme de technicité des concepts. L’équilibre était difficile à tenir. Dans ces situations là, que fait-on ? Je tranche vers : prendre les noms qui reviennent le plus souvent pour développer (et éventuellement citer d’autres noms, mais mollo le name dropping, ça endort tout le monde. Déjà, le nom des gus qu’on explique en long, large, travers, c’est à peine si on s’en souvient, mais alors les quidam qui ont dit vaguement pareil, laissez tomber – les curieux zélés iront faire leur marché dans la bibliographie. Enfin, pour éviter de m’enfoncer dans le buisson de l’histoire des communs (j’adore ça, mais c’est des ouvrages au kilomètre, et dès que je mets un doigt dedans je suis happée, on ne me revoit plus pendant au moins six mois), j’ai opté pour la solution d’aller potasser dans le Dictionnaire des communs (définitivement un investissement intellectuel réussi) : simple, concis, précis ce qu’il faut quand on veut écrire juste quelques lignes sur les enclosures… m’enfin vous vous doutez bien que j’ai aussi été relire mes notes et les articles de La Nature en commun où il était vaguement question de ce phénomène. Notez bien cette dernière précision parce qu’elle a son importance.
Une fois les trois premiers quarts de la vidéo rédigés, on passait à la partie la plus complexe : la critique de la critique. Je m’étais noté à ce propos : « utiliser Communs de Dardot et Laval en tant que thèse critique ». Donc j’ai relu mes notes, relu les pages importantes à cet égard, lu encore quelques pages supplémentaires, écrit quelques paragraphes… Mais ça coinçait. Déjà, à la lecture de l’ouvrage, j’étais mitigée. J’avais la sensation de lire le déploiement d’une grande technicité conceptuelle, d’une grande précision, pour au final un résultat critique pas si incroyable. Bon les critiques qu’ils portent sont en soi intéressantes parce que précises. Mais ce qui en sortait ne me paraissait pas un tableflip conceptuel si impressionnant pour repenser la notion. Pas qu’il faille faire des feux d’artifices pour la beauté du geste hein, mais je me demandais, en écrivant cette partie sur Communs, ce qu’on pourrait en tirer comme levier efficace conceptuellement, qui change la donne – si vraiment ce texte avait marqué l’histoire de la notion.
N’arrivant pas à conclure autre chose que de l’eau tiède avec cette référence, je l’ai laissée un peu de côté, me disant que j’y reviendrais plus tard pour terminer de la traiter dans le script. En fait, j’avais prévu pendant ma documentation de finir la vidéo sur une partie concernant l’historiographie des communs, dont les développements les plus récents sont mentionnés dans La Nature en commun. Il m’avait semblé, en lisant ces papiers, qu’on tenait là une critique de la critique à la fois extrêmement rigoureuse et puissante conceptuellement (le fameux tableflip). Donc j’ai repris mes notes sur ce point, commencé à rédiger, relu le texte d’Alice Ingold… Et puis au final j’ai décidé que, ce script étant déjà trop long (oui j’ai encore des limites, voyez-vous), je n’allais pas m’escrimer à y développer une référence que je n’arrivais pas à valoriser, même pour moi-même. Alors, à la fois pour me faciliter la vie, à la fois par manque d’intérêt, à la fois pour maîtriser mon format, j’ai renoncé présenter Communs comme une référence de critique de la critique, et je me suis autorisée à me focaliser sur l’historiographie des communs comme porteuse des derniers développements critiques en date de la notion de « communs ».
Bon ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, hein : le travail de Dardot et Laval est très intéressant, il mérite qu’on s’y intéresse, qu’on s’y arrête longuement. Cependant, j’ai cette fois-ci fait le choix de me désaxer un peu des références philosophiques (qui sont d’ordinaire mon bac à sable, du fait de ma formation de philosophe, obviously), parce que l’influence de l’histoire m’a paru plus importante pour le terme étudié que l’influence de la philosophie. Noter en cours de documentation l’importance des allers-retours entre discipline historique et luttes sociales/militance m’a fait bifurquer dans ma compréhension du concept. Je pensais trouver surtout un héritage marxiste, la référence du texte sur le vol de bois dont j’avais pu entendre parler pendant mes études. Et in fine, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait plutôt d’une portion congrue, que j’avais un peu mélangé ce sujet avec d’autres (pas encore traités mais encore dans mes tiroirs mémoriels). La production conceptuelle autour des « communs », si elle était fortement transdisciplinaire (droit, philosophie, anthropologie, bref, vous avez vu la vidéo n’est-ce pas), tenait probablement plus de l’histoire et de l’historiographie que d’autre chose – ou bien : l’histoire est centrale pour les autres disciplines. L’analogie de la seconde enclosure, le souvenir des luttes sociales passées mettaient nécessairement le focus sur le travail de l’historien : cet imaginaire est-il bien exact, et comment nourrir les luttes avec de bonnes questions ? C’est dans les textes des historiens que j’ai trouvé, à mon sens, le travail critique le plus directement lié à la forme prise par les développements contemporains du terme de « commun ».
Je me trompe peut-être. Je l’ai précisé en vidéo : mon travail est nécessairement partiel. L’histoire du concept de « commun » est d’une grande richesse, d’une grande diversité. Je l’ai largement taillée pour la faire tenir en deux fois vingt minutes. Les partis pris sont parfois drastiques – et les expliciter dans la même vidéo qu’on essaie de contenir est difficilement envisageable.
Cet article touche à sa fin, et j’espère qu’il aura pu vous éclairer sur ma manière de travailler. Il n’y a pas vraiment de modèle unique pour la documentation et la rédaction d’un script – et tout est en mouvement. Ces articles ne présentent donc au final qu’un exemple, pas un cadre transposable.